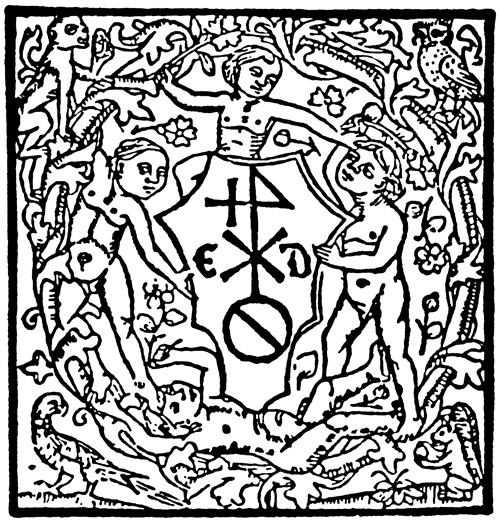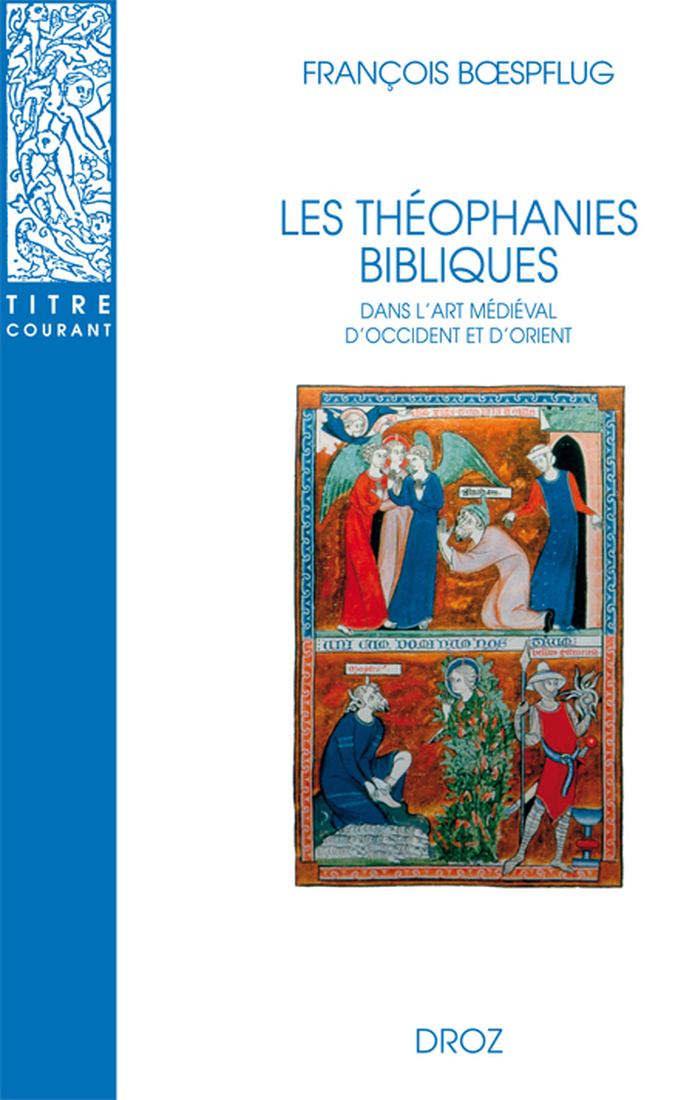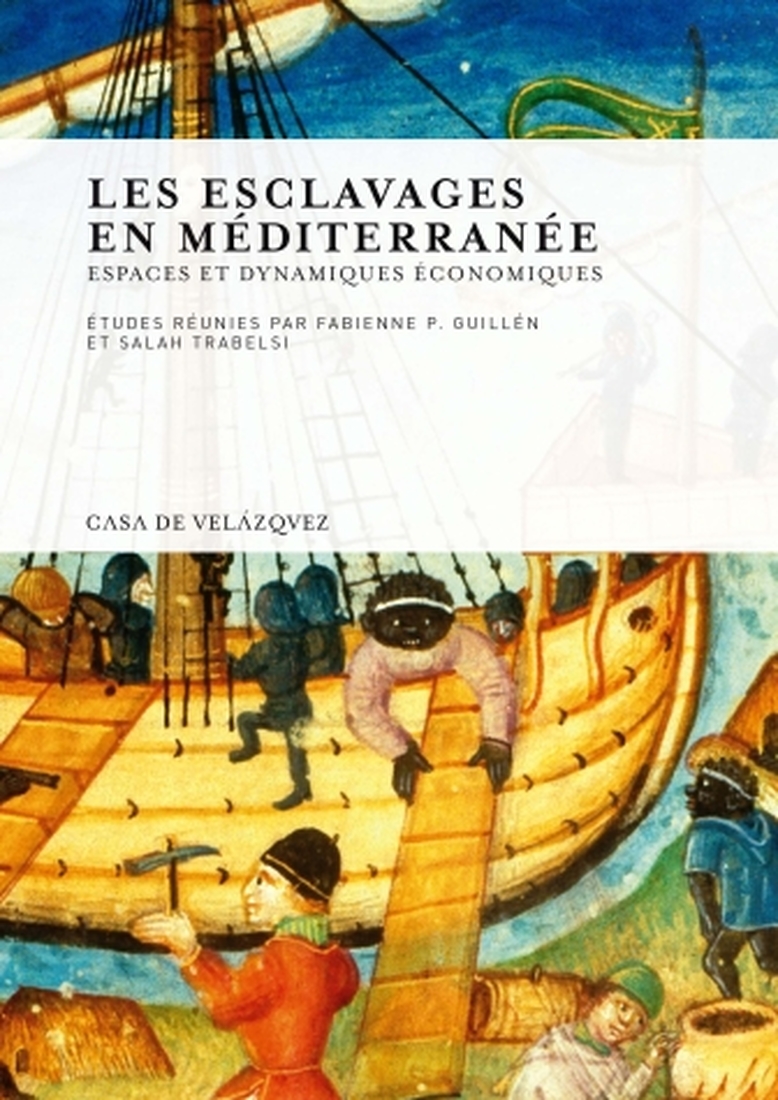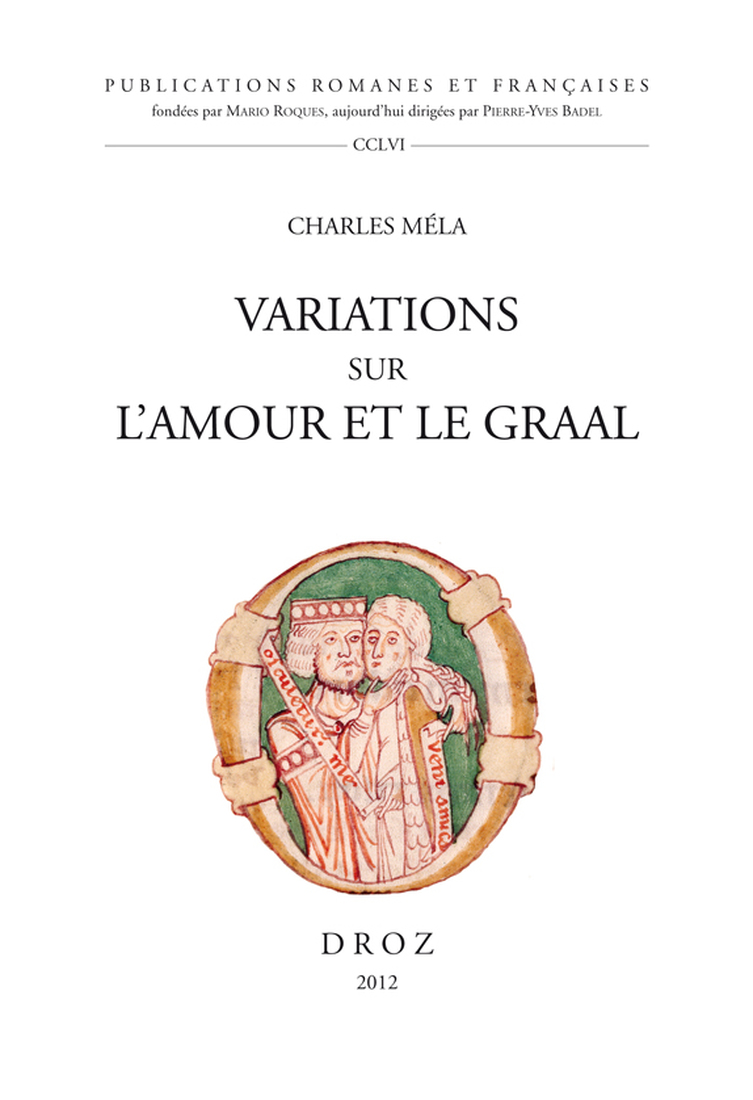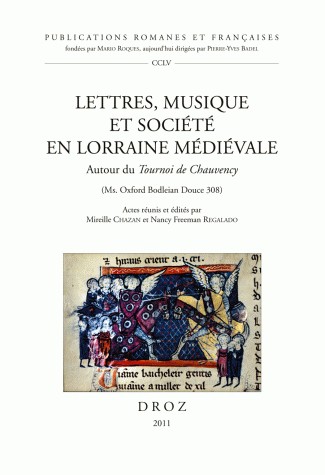Moyen Âge
Comment représenter la manifestation de Dieu dans l’histoire et ses interventions dans le monde des humains ? Le défi à relever, pour les artistes chrétiens du Moyen Âge comme pour leurs éventuels conseillers, était de réussir à montrer l’Invisible de manière à la fois fidèle et respectueuse, en suivant les indications fournies par l’Écriture sainte tout en suppléant tant bien que mal à l’absence des précisions d’ordre spatial que l’œuvre d’art ne peut pas se dispenser de donner à voir. Si bien que la mise en image (peinte ou sculptée) d’une page de la Bible où il est rapporté que Dieu intervient, loin de se réduire à une simple illustration, fut toujours beaucoup plus : une hypothèse inventive, un choix, un pari, où se rencontrèrent la Révélation dont l’Église avait la garde et la sensibilité d’une époque, et où s’affichèrent les préférences d’une génération, les potentialités expressives d’un style, d’un support, d’un lieu. C’est aussi le lieu où a pu se dire, mieux peut-être que nulle part ailleurs, comment a été conçue, imaginée ou vécue, la rencontre avec Dieu. En témoigne cette formidable enquête au pays de l’art médiéval d’inspiration biblique. Quatre théophanies de l’Ancien Testament (Hospitalité d’Abraham, Buisson ardent, vision d’Isaïe et vision d’Ézéchiel) et cinq du Nouveau Testament (Baptême du Christ, Transfiguration, apparition aux disciples d’Emmaüs, vision d’Étienne le protomartyr et conversion de Paul sur le chemin de Damas) sont étudiées tour à tour par François Bœspflug, théologien devenu professeur d’histoire des religions à l’université de Strasbourg, historien de l’art et iconographe au long cours. Ce livre que lon peut dire d’exégèse picturale est indissociablement un traité de théologie biblique par l’image et un condensé d’anthropologie.
Le rapport dialectique entre proximité et éloignement de l’histoire romaine s’est révélé primordial pour l’anthropologie historique occidentale. L'approche lexicologique, jusqu'à présent négligée, permet de suivre la réception de l’Antiquité romaine au Moyen Age. La représentation de la Rome antique a certes été largement étudiée à partir de témoignages artistiques, qu’ils soient littéraires ou picturaux, mais leur soubassement linguistique est trop souvent resté ignoré, alors qu’il constitue une source essentielle d'informations.
Reposant sur le dépouillement de nombreux textes inédits et adoptant une démarche onomasiologique, le présent dictionnaire, destiné aux lexicologues comme aux historiens ou aux chercheurs en littérature, livre un trésor de gloses et de commentaires français, suit pas à pas la constitution d'un lexique de spécialité et tente plus largement de cerner les représentations mouvantes des institutions romaines, qui ont tant fasciné et intrigué le Moyen Age.
Pour la distribution en France : www.sodis.fr
Esclavage, le mot est puissamment évocateur. S'imposent avec lui un espace, l'Atlantique ; une logique marchande, la traite ; un régime d'exploitation, la plantation ; un temps, la modernité ; une couleur, le noir. Lui adjoindre la Méditerranée éveillera sans doute une image seconde, celle des captifs de la course misérablement enchaînés dans les bagnes d'Alger, de Bougie ou de Tunis. Or, l'examiner depuis la Méditerranée et l'affirmer au pluriel, loin de sacrifier à un artifice rhétorique, situe l'ouvrage comme une interrogation de ces deux représentations singulières qui sont généralement confondues. Des rivages baltiques au Sahel, des steppes mongoles au Sahara, vers la mer Intérieure, se révèle un riche nuancier de pratiques de capture, de régimes légaux et de logiques économiques qui structurent les formes multiples et complexes de la privation de liberté : dette, course, piraterie et traites, comme autant de questions adressées à deux représentations de l'esclavage dont la prégnance même reflète ou l'ingénuité ou l'empreinte idéologique.
Regnault et Janneton est une subtile et délicate pastorale de 1129 vers qui met en scène dans un cadre bucolique les amours du berger Regnault, le roi René, et de la bergère Janneton, la reine Jeanne. Le poème a probablement été écrit peu de temps après le mariage du roi avec Jeanne de Laval, sa seconde épouse, le 10 septembre 1454. Il est conservé dans un manuscrit unique de la Bibliothèque nationale de Russie, à Saint-Pétersbourg. L’œuvre a été composée pour être illustrée. Soixante-quatorze dessins à la plume rehaussés de couleurs à l’aquarelle encadrent le texte sur chaque feuillet. A l’origine, ils ont vraisemblablement été conçus par Barthélemy d’Eyck, le peintre favori de René d’Anjou. Les images suivent la narration avec une grande fidélité. L’action se déroule sur vingt-quatre heures, du matin du premier jour au matin suivant. En se dédoublant sous les traits du berger Regnault et du pèlerin-narrateur, René exprime son amour pour Jeanne de Laval, sa jeune épouse. L’œuvre est écrite avec verve et enjouement, sur un ton rendu vif et alerte par une versification habile et complexe. Une multitude de notations réalistes témoignent du goût de l’auteur pour la description de la nature et l’observation des espèces animales.
Depuis 1929, le poème n’était généralement plus attribué à René d’Anjou. A partir de critères linguistiques, biographiques, littéraires et iconographiques, Gilles Roussineau réattribue l’œuvre au roi René. Le texte édité est accompagné d’une traduction, de notes et d’un glossaire. La reproduction en couleur de seize peintures complète l’ouvrage.
Cet ouvrage propose une double réflexion sur la poétique du roman au XVIIIe siècle, telle qu’elle était mise en pratique, et telle que nous pouvons la repenser aujourd’hui, à partir notamment des nombreuses protestations d'authenticité que l'on trouve dans les fictions de l’époque.
S’appuyant sur l'analyse de textes publiés par Courtilz de Sandras, Lesage, Prévost, Marivaux et Diderot, cette étude montre que, contrairement à ce qu’a longtemps affirmé la critique, ces romanciers n’ont pas pour objectif d’abuser de la crédulité du public. L’avertissement initial « ceci n’est pas un roman » indique paradoxalement aux lecteurs qu'ils ont affaire à une fiction. Le présent ouvrage met en lumière cet aveu de la fiction par sa dénégation même, et l’attitude paradoxale des auteurs qui déploient une panoplie de topoi et de procédés destinés à « faire vrai » tout en s’ingéniant à « faire faux ». Leur lecteur oscille donc en permanence entre deux positions : celle qui l’immerge dans la fiction et celle qui l’en arrache. Chacun des textes étudiés apparaît comme un espace de jeu qui suppose la participation active du lecteur, ouvrant la voie à la modernité littéraire.
Lire, c’est, comme Perceval au Château du Graal, entrer dans la voie d’une transformation qui ouvre les yeux du cœur. Déchiffrer, commenter au plus près de la lettre du texte, c’est aussi faire un travail sur soi, afin d’acquérir un autre regard. Comprendre, en lisant, qu’il s’agit de soi – tua res agitur, comme disait Horace – permet à une œuvre, si ancienne soit-elle, de gagner en modernité : pouvoir de la littérature d’impliquer la vie de chaque lecteur personnellement, sous prétexte de le divertir – plaire en instruisant, toujours selon Horace.
En témoigne le présent ouvrage, en forme de Variations sur l’amour et le Graal, qui distille l’essence d’un enseignement sur plus de quarante ans à Paris, Yale et Genève. Notre dette au Séminaire de Jacques Lacan signe cette rencontre entre la psychanalyse et les arts du langage.
Le manuscrit Oxford Bodl. Douce 308, copié et illustré à Metz vers 1314, offre une grille de lecture privilégiée de la richesse et la diversité de la société aristocratique dans laquelle il a été élaboré et transmis. Il rassemble à la fois des œuvres à succès du XIIIe siècle, mais aussi des pièces plus récentes : une addition au Roman d’Alexandre, les Vœux du paon de Jacques de Longuyon (vers 1310) ; le Bestiaire d’Amours de Richard de Fournival (vers 1250) ; le récit d’une fªte chevaleresque, le Tournoi de Chauvency de Jacques Bretel (1285) ; un chansonnier de plus de 500 pièces (après 1309) ; un roman allégorique, le Tornoiement Antéchrist de Huon de Méry (vers 1234).
Dans le présent volume, historiens de la littéra?ure, de la culture urbaine et aristocratique, de l’art et de la musique sont réunis afin d'étudier cette œuvre exceptionnelle. Certains tissent les liens entre textes, chansons et images qui composent le manuscrit. Tandis que d'autres s’interrogent sur le contexte artistique et culturel dans lequel s'inscrit le manuscrit :ses bibliothèques, ses rites et ses fêtes.
«Que diable de langaige est cecy ? Par dieu tu es quelque heretique ». En ce qu’elle déduit d’un « diable de langaige » la représentation de « l’autre », la célèbre réaction de Pantagruel aux paroles de l’écolier limousin, «qui contrefaisoit le langaige Françoys», est symptomatique de l’association que suscite, dans la fiction comme dans l’opinion que professent les auteurs sur leurs choix d’écriture, la confrontation à une langue repoussoir. Est posée la question de la confrontation à cet « autre », auteur, scripteur, énonciateur du texte-source, qu’il soit identifié ou anonyme, réel ou fictif, en fonction duquel se construit la figure de l’auteur en quête d’identité. Ce n’est pas seulement un discours théorique, mais un imaginaire qui en témoigne, par lequel l’auteur à naître s’approprie de façon souvent très consciente, dans l’émulation, la séduction, la contestation, et non sans mauvaise foi ni brutalité parfois, la richesse du texte qu’il récrit, construisant à son tour une image collective de la littérature qu’il cherche à promouvoir comme une élaboration propre.
L’ouvrage entend discerner, à travers la diversité des langues et de leurs statuts, les modalités d’un processus d’affirmation littéraire et linguistique, en deux périodes où il s’opère par excellence, la renaissance du XIIe siècle et la Renaissance française au XVIe siècle. C’est que les deux périodes envisagées présentent pour caractéristiques communes la revendication d’une littérature en langue vulgaire et, simultanément, l’affirmation du statut de l’auteur, comme si le processus souvent glosé de la translatio studii était indissociable de la prise de conscience individuelle.